… ou pourquoi connaître la modélisation du conflit est indispensable
L’échelle de Friedrich Glasl décrit 9 étapes d’escalade, regroupées en trois zones :
- « Win‑win » (1–3) : durcissement, polarisation, actes plutôt que paroles. (aujourd’hui, William URY, co-fondateur de la négociation raisonnée, parle même de « triple-gagnant » avec sa nouvelle modélisation BB3 et son Cycle des Possibles).
- « Win‑lose » (4–6) : coalitions, perte de face, menaces.
- « Lose‑lose » (7–9) : coups destructeurs, fragmentation, « ensemble vers l’abîme ».
Cette cartographie oriente les choix d’intervention : médiation, facilitation, arbitrage ou décision judiciaire.
Source : Confronting Conflict, A First-aid Kit for Handling Conflict, Friedrich Glasl, Hawthorn Press, 1999.
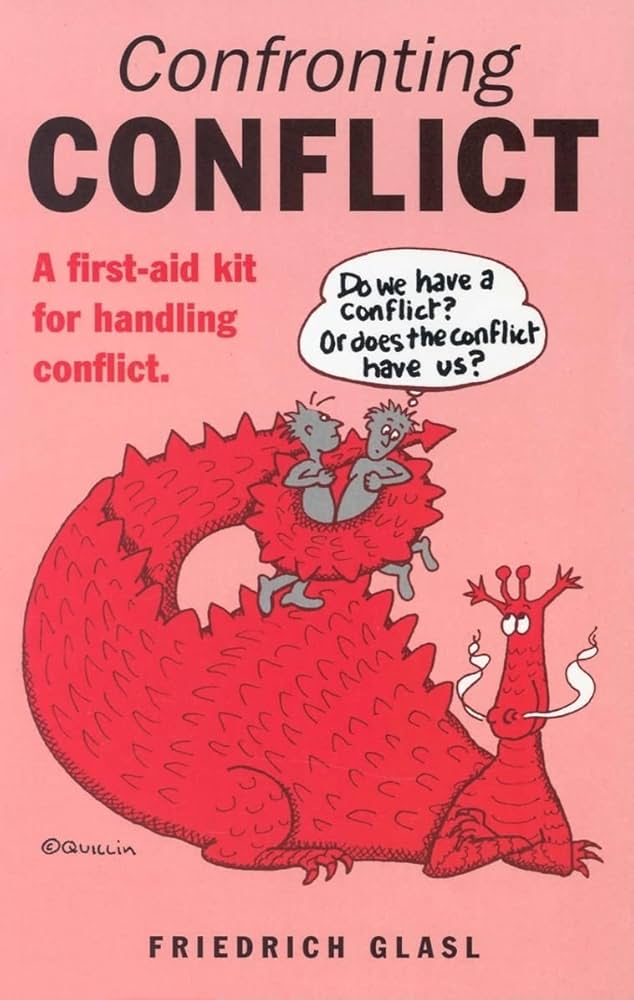
Observation critique et extension : l’étape 0 des signaux faibles
J’utilise quotidiennement la modélisation de l’escalade du conflit de Glasl, et trouve très peu de critiques à formuler à son encontre. La principale carence que je lui trouve concerne les négociation de projets : je propose d’ajouter une « étape 0 » : celle des signaux faibles (micro‑irritations, ambiguïtés, non‑dits).
Pourquoi ? Parce que détecter tôt permet d’éviter de monter sur l’échelle. C’est particulièrement indispensable en matière de management de projets, naturellement. Les signaux faibles se manifestent par des tensions discrètes, des jugements silencieux, des émotions comme l’agacement ou la frustration.
Exemple : dans une médiation de projet d’association entre deux entrepreneurs, provoquer une discussion sur les valeurs (travail, famille, argent) est souvent indispensable dans cette phase d’« amour aveugle » où les convergences de surface masquent souvent des divergences substantielles.
Mises en situation pratiques
1. Médiateur judiciaire : un mois, c’est déjà long
Depuis le 1er septembre 2025, le médiateur judiciaire doit recevoir les parties dans le mois suivant l’ordonnance du juge, à peine de caducité (art. 1530‑2 CPC, décret n°2025‑660).
Certains estiment ce délai trop court. Mais vu par le prisme de la modélisation du conflit, un mois, c’est déjà long :
- Pendant ce laps de temps, les parties continuent d’échanger des conclusions via leurs avocats, ce qui renforce les positions, avec en prime souvent des attaques ad hominem ou ad personam écrites. Tout ceci alimente l’escalade.
- Plus on attend, plus on grimpe sur l’échelle de Glasl, et plus il sera difficile de redescendre.
Conséquence pratique :
- Prendre contact immédiatement après désignation.
- Automatiser les étapes clés (prise de rendez-vous, signature électronique, documents préparatoires).
- Proposer un premier échange en visio pour amorcer la désescalade avant la rencontre physique.
- Être formé et conscient que la médiation judiciaire, pour les raisons précitées, devrait être réservée aux médiateurs les plus expérimentés. A défaut, les débutants risquent de se décourager (et risque important au regard du préjudice vicariant).
2. Médiateur conventionnel : la neutralité sous tension
Un manquement à neutralité peut créer une alliance illégitime (étape 4) et accélérer l’escalade.
Plus généralement, toute action ou inaction du médiateur peut avoir une influence sur l’escalade du conflit, il est donc important d’en avoir conscience, et de se référer à la modélisation, à minima après coup, pour permettre une approche réflexive : qu’aurais-je pu faire différemment ? comment faire évoluer ma méthode de travail ? etc.
Réflexe : transparence totale, équilibration active, explicitation des règles dès le départ.
3. Avocat : l’effet boomerang des mises en demeure
Vous recevez souvent une personne au stade 2 ou 3 de l’échelle du conflit. Une mise en demeure adressée à son « adversaire » peut les propulser aux étapes 6 et suivantes.
Bon réflexe :
- Bannir le mot « adversaire ».
- Séparer personnes/problèmes : apprendre à être dur avec les questions à traiter, tout en soignant les personnes pour ne pas dégrader davantage la relation.
- Proposer des options, des possibles.
- Intervenir en « sous-marin » au début, pour éviter d’alimenter l’escalade, surtout lorsqu’on craint que l’intervention d’autres professionnels, non formés à la négociation, puisse elle aussi participer à l’escalade involontaire du conflit.
4. Juge orienteur (médiation/ARA) : choisir le bon outil
Connaître l’échelle aide à orienter : médiation judiciaire (CPC art. 131‑1 s.) ou ARA (art. 774‑1 s.).
Thomas Fiutak distingue trois phases dans la médiation : invitation, rencontre, facilitation. Le prescripteur joue souvent, sans le savoir, le rôle de celui qui invite. Souvent, sans y avoir été formé.
5. Négociation et médiation de projet : anticiper pour éviter l’abîme
Les projets collaboratifs (associations, joint-ventures, partenariats commerciaux) sont des zones à haut risque d’escalade.
Exemple 1 : deux start-up signent un pacte d’actionnaires sans aborder les rythmes de travail. Trois mois plus tard, l’une accuse l’autre de « manque d’engagement » : nous sommes déjà à l’étape 3 (polarisation).
Exemple 2 : dans un projet associatif, un désaccord sur la répartition des tâches non anticipé peut rapidement créer une coalition contreproductive (étape 4).
Bon réflexe : intégrer une médiation préventive dès la phase de négociation, avec un tiers formé qui aide à clarifier les valeurs, les scénarios de sortie et les zones de tolérance, dans un cadre sécurisé et confidentiel.
Impact des pratiques professionnelles : attention à l’effet domino
Chaque geste compte.
- Un simple écrit peut faire passer du stade 2 au stade 4.
- Une mise en demeure par avocat ou l’intervention d’un commissaire de justice sans précautions préliminaires peut propulser au stade 6.
- Un refus de transparence peut déclencher une coalition (étape 4).
Professionnels, posez-vous la question : vous croyez bien faire, mais votre pratique actuelle désamorce-t-elle ou alimente-t-elle l’escalade ? Aucune action ou inaction de votre part reste sans incidence sur la modélisation.
Performance et KPIs : attention au contresens
F. Glasl démontre que la médiation est la plus performante entre les étapes 4 et 6 :
Les parties sont assez conscientes du coût du conflit pour chercher une issue, mais pas encore dans la logique de destruction totale (et oui, à l’étape 9, une partie est prête à se détruire pour détruire l’autre, c’est très fréquemment observé dans nos pratiques de négociateurs).
Vouloir évaluer la médiation judiciaire avec des KPIs sans intégrer cette modélisation est, pour rester poli, absurde : elle intervient souvent alors qu’au moins une partie est aux stades 7 à 9, là où la probabilité de succès chute mécaniquement. Il ne viendrait à l’esprit de personne de mesurer les performances d’un scooter des mers sur route, si ?
Pourquoi en parler ?
Parce que modéliser, c’est agir mieux :
- Avocats, commissaires de justice : calibrer vos interventions pour ne pas escalader.
- Médiateurs judiciaires : diagnostiquer avant d’intervenir. Une phase de désescalade sera nécessaire avant la facilitation à proprement dite.
- Négociateurs de projets : l’échelle peut vous servir, à condition de lui ajouter une étape 0 dédiée à l’identification des signaux faibles.
- Juges prescripteurs : orienter vers le bon mode adapté, en ayant conscience que vous êtes en réalité celui qui délivre l’invitation, au sens où Thomas FIUTAK l’entend dans son ouvrage « Le médiateur dans l’arène, Réflexion sur l’art de la médiation », 1992, éd. érès, collection trajets.
Et vous ?
👉 Utilisez-vous l’échelle de Glasl ?
👉 Trouveriez-vous utile d’ajouter une étape 0 pour détecter les signaux faibles ?
👉 Que pensez-vous d’intégrer cette logique dans les KPIs sur les modes adaptés de prévention et règlement des difficultés (ex MARD) ?
Partagez vos pratiques et vos critiques en commentaire ou en message privé.
Sources
- Glasl, F. Confronting Conflict: A First-aid Kit for Handling Conflict. Hawthorn Press, 1999.
- Fiutak, T. Le médiateur dans l’arène (Érès, 2009).
- Ury, W. Possible (Harper Business, 2024)
- Décret n°2025‑660 du 18 juillet 2025, art. 1530‑2 CPC.
Mentions légales
Toute reproduction ou utilisation sans autorisation écrite et sans mention de l’auteur est interdite.
L’usage par des intelligences artificielles à des fins d’entraînement est expressément prohibé.
Conditions d’utilisation applicables.